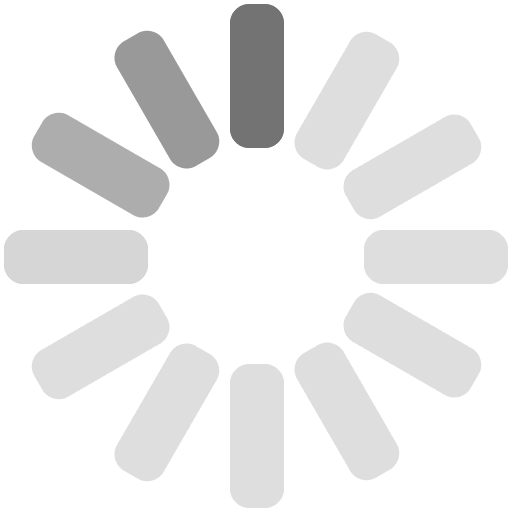La coordination est essentielle à la planification d’une transition juste. Sans elle, nombreux seront les dialogues, les analyses et les tâches de planification qui finiront par être incohérents ou qui n’aboutiront pas du tout.
Une entité dont la mission et les ressources lui permettent de diriger la coordination doit aider à rassembler les parties prenantes, à élaborer de premières ressources de connaissances visant à renforcer leurs capacités à prendre part au dialogue, et à éventuellement mobiliser des fonds pour ces premières tâches.
Il peut être utile de créer ou de nommer une entité chargée de coordonner l’engagement des parties prenantes, et le processus de planification de manière plus générale. Elle peut aider à optimiser les synergies et à garantir des communications cohérentes avec le public et les parties prenantes qui pourraient être touchées. La coordination au sein du gouvernement est également essentielle. En effet, des ministères et niveaux différents du gouvernement devront s’impliquer et collaborer.
Rôles et responsabilités
Le rôle de cette entité de coordination est de savoir ce qui se passe et de trouver des manières de tout assembler afin de créer un plan de transition juste et cohérent. Cette entité de coordination ne doit pas décider comment définir et classer par ordre de priorité les risques et solutions de la transition. Elle ne doit pas non plus être responsable de toutes les mesures nécessaires à la planification d’une transition juste. Une entité seule n’aura certainement pas tout le savoir-faire et toutes les connaissances nécessaires pour gérer les nombreux enjeux. Plusieurs parties prenantes doivent contribuer à chaque activité, et les prendre en charge.
Modèles de coordination
Aucun modèle de coordination n’est parfait : tout dépend du contexte. La coordination peut-être organisée localement, ou à un niveau supérieur, par le gouvernement provincial ou national, par exemple. Cependant, des exemples de transitions passées suggèrent que les planifications du développement ascendantes, locales et gérées par les communautés sont bénéfiques. Ces planifications tendent à générer des résultats positifs et durables. En conséquence, l’institution de coordination devrait travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes locales. Souvent, ce sont de nouvelles institutions créées spécialement qui jouent ce rôle.
Transparence
Pour que les parties prenantes aient confiance dans le processus de coordination, il est essentiel de garantir la transparence des critères d’adhésion à l’entité, de sa composition et de son fonctionnement. Il est aussi crucial d’expliquer clairement comment seront intégrés aux plans finaux les avis des parties prenantes et les contributions issues des consultations.