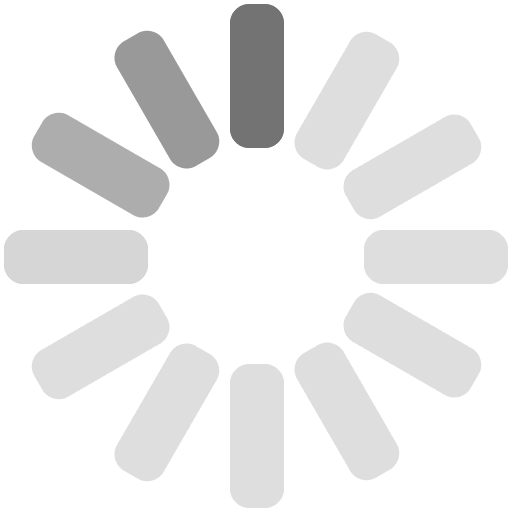Partout dans le monde, de grands changements se dessinent dans des secteurs essentiels de notre société : notre production et notre consommation d’énergie, de biens et même de nourriture ; nos déplacements ; la gestion de l’eau et des déchets ; la gestion et la protection de nos ressources naturelles et des paysages ; et la production des biens et services dont dépendent nos économies. Ces changements sont insufflés par le besoin de lutter contre le changement climatique et de s’attaquer aux nombreuses autres externalités environnementales et sociales de nos pratiques actuelles de consommation et de production. Mais ces changements sont également provoqués par l’adoption de nouvelles technologies, les marchés en pleine mutation ou les préférences fluctuantes des consommateurs.
Les grands changements socioéconomiques, qu’ils soient locaux ou nationaux, sont souvent synonymes de bouleversements. Une économie plus verte et des processus de production plus durables bénéficieront dans l’ensemble à la société, mais la transition peut aussi engendrer de nouveaux coûts et de nouveaux risques pour certaines personnes. Par exemple, certaines d’entre elles pourraient perdre leur emploi ou souffrir des effets négatifs pesant sur leur activité économique locale, même si la transition permet dans l’ensemble d’augmenter le nombre d’emplois ou de renforcer l’activité économique.
Ces perturbations, si elles ne sont pas gérées avec attention, pourront avoir d’importants effets sur les populations, surtout sur les personnes et les communautés dont les moyens de subsistance seront touchés, ou sur celles qui étaient déjà vulnérables. Ces conséquences néfastes pousseront ensuite les populations locales à résister à la transition.
Le concept de transition juste encourage les planificateurs et les autres parties prenantes à :
- Promouvoir activement des processus d’inclusion sociale au moment de la planification et de la mise en œuvre de la transition (soit garantir la « justice procédurale »).
- Limiter les coûts ou les autres effets néfastes de la transition là où ils pèsent de manière injuste sur certains groupes ou provoquent des difficultés, et concevoir une nouvelle économie qui permet la répartition des bénéfices dans toute la société (soit garantir la « justice distributive »).
- Exploiter autant que possible la transition pour également réformer les structures sociales ou économiques existantes à l’origine d’injustices et/ou de vulnérabilités (soit promouvoir la « justice restaurative »). Des transitions bien pensées peuvent être exploitées pour apporter de nombreux changements positifs dans les communautés et les régions.
Beaucoup d’enjeux sociaux, économiques et environnementaux doivent être pris en compte et dans le cadre de la gestion du processus de changement. Parmi ces enjeux se trouvent les effets sur les travailleurs, qui sont touchés par le ralentissement progressif de certains secteurs, ainsi que d’autres effets économiques ou sociaux qui peuvent toucher les communautés locales, les petites entreprises et les gouvernements locaux. Dans certains secteurs, l’une des grandes inquiétudes à ce sujet est de savoir comment gérer les effets de l’économie actuelle sur l’environnement, comme les forêts dégradées, les sols pollués ou les anciennes exploitations minières.
Lors de la planification, il est aussi essentiel d’identifier clairement comment les différentes formes de discrimination ou de marginalisation croisées, basées sur le genre, l’origine, l’ethnicité, l’âge, etc., peuvent influencer la répartition des coûts et des bénéfices. Il est nécessaire d’élaborer des stratégies afin de tout faire pour que l’adoption de nouvelles pratiques et le passage à de nouvelles industries réduisent les inégalités et ne les augmentent pas.
La planification de transitions justes peut servir de lien entre l’action climatique et la promotion d’autres objectifs de développement durable, car elle couvrira de nombreuses questions de politique sociale, environnementale et économique. Pour ce faire, les stratégies imaginées pour promouvoir les transitions justes doivent respecter les autres politiques et plans qui partagent les mêmes objectifs. Dans le même temps, il peut s’avérer nécessaire de modifier, ou grandement réformer, des politiques, des plans et des règles budgétaires afin de respecter la vision de la transition juste.
L’une des activités importantes du début de la planification est de trouver un accord entre les parties prenantes afin de pouvoir définir les objectifs d’une transition juste, et ce dans n’importe quel contexte, ainsi que les principes à suivre lors de la planification (voir le Module 2.3).