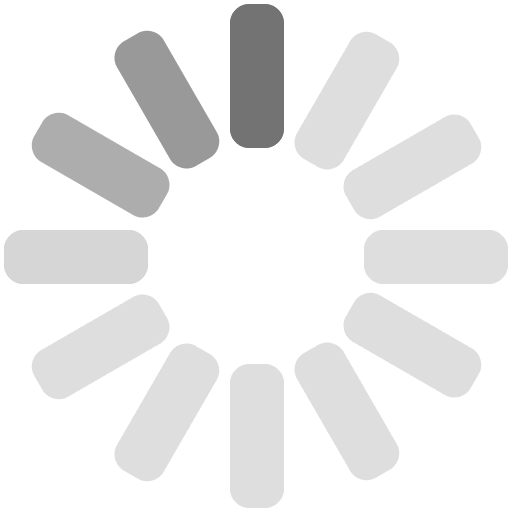Les inégalités de genre et les manières différentes de vivre la transition en fonction du genre sont essentielles au contexte socioéconomique, qui doit être compris afin de garantir des résultats justes et de concevoir un processus juste et inclusif. De nombreux outils utilisés pour l’analyse des questions de genre optent aussi pour une approche intersectorielle : ils reconnaissent que les identités multiples et croisées de chaque individu (son genre, son origine ou ethnicité, son âge, son handicap, ses capacités, etc.) influencent ses vulnérabilités ou avantages.
Une analyse des questions de genre commencera par explorer comment sont répartis les risques et les opportunités de la transition. La main-d’œuvre exposée aux pertes d’emplois dans certains secteurs à forte intensité carbone, comme celui des énergies ou de l’exploitation minière, est souvent très masculine. Cependant, si les hommes perdent leur emploi, cela signifie que ce poids pourrait retomber sur les épaules des femmes. En conséquence, les femmes auront moins de temps pour s’instruire, se lancer dans les affaires ou accéder aux services de santé en cas de besoin. Parfois, la hausse des taux de chômage est synonyme d’une hausse des taux des violences fondées sur le genre. Les inégalités entre les genres peuvent aussi nuire aux capacités des femmes à s’adapter à de nouvelles conditions. Par exemple, les femmes représentent souvent une grande partie des agriculteurs et des ouvriers agricoles. Cependant, elles sont bien moins susceptibles que les hommes de posséder des terres, ce qui les rend plus vulnérables aux changements systémiques.
Une analyse des questions de genre peut aussi identifier les possibilités de corriger certaines des inégalités existantes, fondées sur le genre ou d’autres facteurs, en mettant au point des mesures qui visent la cause de ces inégalités (voir le Module 4.2).
Il est essentiel que les analyses des questions de genre soient solides, spécifiques au contexte et intersectionnelles. Elles permettent d’identifier les types d’inégalités de genre ainsi que leurs causes, et la manière dont elles peuvent influencer les effets d’une transition.
Les études de fond sur les inégalités de genre et les vulnérabilités doivent prendre en compte des indicateurs tels que la participation au marché du travail local et l’accès à l’éducation, aux services de santé et aux services financiers et de protection sociale (voir le Module 2.2.6). Elles doivent aussi être ventilées selon d’autres variables sociales, comme l’âge.
Les études de fond doivent être complétées par une analyse des questions de genre, spécifiquement en rapport avec la transition. Pour ce faire, il faut intégrer les questions de genre aux analyses menées lors de la préparation des stratégies de transition juste (voir le Module 3), comme les évaluations des dynamiques du marché du travail, des effets économiques et des options de diversification, des risques environnementaux et des priorités de remise en état, et d’autres effets sociaux.
Un manque de données ventilées par genre, surtout aux niveaux local/municipal dans les territoires touchés, peut empêcher de mener une analyse approfondie des questions de genre. À l’inverse, renforcer la collecte des données et les mécanismes d’analyse afin d’obtenir plus de données ventilées permet de mieux soutenir la planification de la transition, mais aussi les activités futures de suivi et d’évaluation.